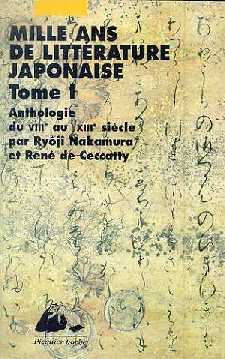
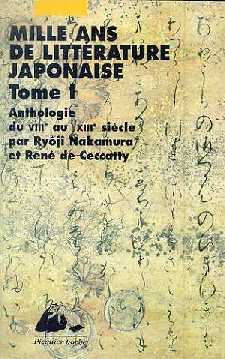 |
Mille ans de littérature japonaise (Anthologie de R. de Ceccatty & R. Nakamura)
Le problème se posait depuis longtemps. Comment lire une anthologie
? Dans quel but ? Comment en rendre compte ?
La lecture des deux tomes de Mille ans de littérature japonaise,
émaillée de ces questions, mettait en cause la classification
même de ce genre de livre : œuvre à part entière ?
compilation de textes choisis ? La seconde idée me paraissant être
la plus juste, du moins la plus appropriée au contenu de ce recueil,
j'ai donc décidé de vous proposer les commentaires des textes
qui me semblaient les plus intéressants dans le sens où leur originalité
a marqué un tournant dans l'histoire de la littérature japonaise.
Une seconde anthologie en somme.
L'anthologie commence par le Journal de Tosa (Tosa Nikki),
texte du 10ème siècle. Cette œuvre a le mérite d'inaugurer
le genre du journal qui connaîtra un développement important par
la suite. L'apparition de ce genre coïncide avec deux faits importants
: la japonisation de l'écriture et l'élaboration du style du waka
(poème japonais). Il faut savoir que, jusqu'alors, pour écrire
japonais, on se servait phonétiquement de caractères chinois,
la langue administrative écrite étant, par ailleurs, le chinois.
C'est au cours du 9ème siècle que les femmes, qui ignoraient les
caractères chinois, créèrent une écriture phonétique
dite kana. L'usage de cette écriture "féminine" n 'était
pas destinée aux hommes, ce qui explique le "travestissement"
de l'auteur de ce journal : Ki no Tsurayuki a déguisé son identité
dans ce texte puisque la narration est confiée à une femme (suivante
? simple narratrice imaginaire ?) qui se confond de temps à autre avec
le personnage du gouverneur, un vieil homme.
L'émotion de ce texte va croissante, liée à la situation
particulière du gouverneur : il revient dans un lieu défiguré
par la mort de sa fille. Ce retour des parents dans la maison familiale sans
l'enfant qui avait accompagné leur départ conclut le journal.
Le narrateur se résout au silence et à la disparition : "
Il reste des évènements qui dépassent la mémoire
et l'expression.
De toute façon, je déchirerai ces pages. "
La fin du 11ème siècle verra naître deux genres très différents : le roman historique (rekishi monogatari) et le roman de psychologie baroque : Si je pouvais les intervertir (torikaebaya monogatari) en est un exemple. L'histoire est intéressante et perverse à souhait. Un ministre a de deux femmes différentes un fils et une fille. Le garçon est efféminé et va être élevé comme une fille ; la fille, d'allure garçonne, sera élevée comme un garçon. Leur père, à force de répéter torikaebaya monogatari, fait de son fils la dama d'honneur de la princesse impériale et marie sa fille, devenue conseiller, à une femme. L'accumulation des divers travestissements est sans aucun doute un avant goût du marivaudage français, si ce n'est que le déguisement n'est pas prétexte à badiner mais à séduire des personnes du même sexe que soi.
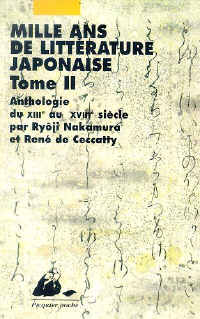 Les
contes du recueil Kanjaku monogatari, La voleuse inconnue, Dans
le fourré et Un amour de Heichû datent du début
du 12ème siècle. Ce qui est surtout intéressant ici c'est
la popularisation du bouddhisme, l'insistance sur la vie quotidienne jusque
là exclue par la littérature de cour, et en particulier la vie
sexuelle, ce qui n'est pas sans évoquer le Décaméron
de Boccace. Ces contes constituent par ailleurs un témoignage
essentiel sur la classe des guerriers. Les derniers contes manifestent l'imagination
la plus libre et ont donné lieu à des adaptations modernes de
Ryûnosuké Akutagawa, comme Dans le fourré
dont Akira Kurosawa a tiré son film Rashômon.
Les
contes du recueil Kanjaku monogatari, La voleuse inconnue, Dans
le fourré et Un amour de Heichû datent du début
du 12ème siècle. Ce qui est surtout intéressant ici c'est
la popularisation du bouddhisme, l'insistance sur la vie quotidienne jusque
là exclue par la littérature de cour, et en particulier la vie
sexuelle, ce qui n'est pas sans évoquer le Décaméron
de Boccace. Ces contes constituent par ailleurs un témoignage
essentiel sur la classe des guerriers. Les derniers contes manifestent l'imagination
la plus libre et ont donné lieu à des adaptations modernes de
Ryûnosuké Akutagawa, comme Dans le fourré
dont Akira Kurosawa a tiré son film Rashômon.
Le Soliloque (Towazugatari), écrit par la "Dame de Nijô", voit le jour au début du 14ème siècle. L'histoire, qui se déploie sur près de trente années, est somme toute assez banale : une femme nous parle de ses trois amants successifs, de l'enfant qu'elle aura du dernier, du voyage qu'elle entreprend à travers le pays…Le monde où l'auteur situe le récit de ses déboires amoureux a perdu tout faste aristocratique ; la description psychologique n'en gagne que plus de poids. Ce livre a le mérite d'être la première tentative de totalisation d'une vie et, à la différence du Roman de Genji, il est centré sur une seule personne en butte aux manœuvres de cour et à la perversité d'un empereur décadent.
La structure de l'iki (Iki no kôzô) est un livre étonnant écrit par un professeur de philosophie à l'université de Kyôto, un dénommé Kuki, ami de Heidegger. Le terme iki renvoie à une sorte de dandysme. Kuki tente de définir ce mot qui ne se prête guère à la philosophie avec un vocabulaire emprunté à la phénoménologie de Husserl et de Heidegger et selon une démarche progressive : d'un point de vue historique, sémantique, dans ses expressions corporelles, dans ses expressions artistiques. Il est clair que ce texte tire son originalité par le contraste entre la notion étudiée et la démarche suivie.
Les autres œuvres sont à découvrir dans l'anthologie…
Ségolène, mai 2001
Anthologie : Mille ans de littérature japonaise. P. Picquier poches, 2 tomes.