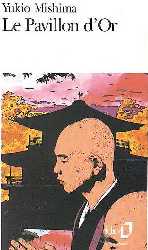
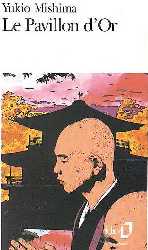 |
Mishima Yukio : Le Pavillon d'Or (Kinkakuji) (1956)
Dans les tous premiers jours de juillet 1950, le japon consterné apprenait
qu'un incendie criminel venait d'anéantir l'un des plus célèbres trésors nationaux,
le Pavillon d'or du temple Rokuonji, à Kyoto. La fin absurde de cette merveille,
épargnée pendant plus de cinq siècles par le feu et la guerre, fut ressentie
comme un désastre total et irréparable, surtout pour l'élite cultivée du Japon.
De ce fait divers, les grands journaux eurent de la copie pour leurs millions
de lecteurs quotidiens ; de son côté, un jeune écrivain de trente ans en fit
un roman, tiré à 300 000 exemplaires.
Il serait vain de chercher dans Le Pavillon d'Or certaines traces
de ce qu'il est convenu d'appeler "la génération de la défaite" à laquelle Mishima,
par son âge, appartenait. Nulle trace non plus de ce nihilisme désespéré d'adolescents
sans boussole et sans riz. Ce qui se reflète dans ce livre, ce n'est pas le
Japon vaincu et sous-alimenté de l'après-guerre mais bien plutôt un Japon dynamique,
conquérant, celui qui s'est retrouvé sans s'être jamais véritablement perdu.
La fidélité de Mishima à l'histoire réelle s'impose avec évidence au cours de
la lecture (il s'était inspiré du journal du criminel ainsi que des comptes
rendus du procès).
C'est l'histoire, en somme, d'un fait divers. Mais la façon dont elle est conduite,
comme la nuance du regard porté sur les choses, sont bien loin de celles des
écrivains naturalistes. Non qu'on ne sente à l'occasion la chasse au document,
le travail sur notes : c'est l'évidence pour tout ce qui a trait au bouddhisme
Zen (cérémonies, emploi du temps, exercices...). Mais une certaine ampleur de
conception, une écriture sans parti pris de banalité, installent le livre dans
un éclairage bien différent des grisailles écœurantes des romans de Zola.
Que l'ambition de Mishima soit de parvenir à la force expressive par les voies
du naturel, ces lignes de son Journal semblent le donner à penser
: "Je me suis mis peu à peu à aimer pour le roman un style qui n'a l'air de
rien et, parfaitement détendu, regorge de vitalité". La confidence vaut qu'on
la retienne. Du Journal encore : "Mon Kinkakuji
est une étude approfondie des mobiles d'un crime. Une conception superficielle
et baroque de quelque chose comme, par exemple, la Beauté, peut suffire à provoquer
l'acte criminel d'incendier un trésor national. Si l'on se place d'un autre
point de vue, il suffit, pour échapper à sa condition présente, de croire à
cette idée folle et superficielle, et de l'hypertrophier jusqu'à en faire une
fondamentale raison d'être. C'était le cas de Hitler..". Ce qui, importe dans
ces réflexions est moins le projet d'une investigation psychologique minutieuse
(les romanciers pratiquant volontiers ce genre de fouilles), que l'invention
et la mise au point d'un mécanisme, fort ingénieux, de déviation paranoïaque.
La fascination, mais aussi l'énigme de la Beauté, jouent un rôle déterminant
dans le déclenchement du processus. Aussi, loin de renoncer (comme le fit le
vrai coupable) à invoquer le mobile d'une haine sans merci pour la Beauté sous
toutes ses formes, Mishima a, au contraire, maintenu, du comportement de son
héros, cette explication, à laquelle il a donné une dimension assez extraordinaire.
C'était accroître la difficulté, s'obliger somme toute à mener le combat sur
deux fronts : celui de la simple psychologie et celui de l'esthétique. On voit
le péril, le risque pour l'ouvrage de basculer dans un sens ou dans l'autre,
de voir son unité sans cesse remise en question. Il arrive que le talent de
Mishima sache trouver un subtil et poétique joint : ainsi, aux minutes décisives
de la vie du héros, la réapparition automatique du pavillon d'or, d'un pavillon
d'or immatériel, désincarné, émanation de l'autre, obsession et mirage, et qui
de plus en plus agit à la façon d'un mauvais sort, d'un mauvais songe. Là est
la grande et belle trouvaille du livre.
Le pavillon d'or de Mishima est également un livre qui sait ménager de ces précieuses
minutes où le cœur et l'esprit s'emplissent des couleurs du Japon. Ici, c'est
une notation psychologique extraordinairement ténue (le petit bonze à la tête
rasée a l'impression de connaître le monde aussi par la peau de son crâne) ou
vers la fin du livre, l'étonnante analyse de la sensation produite par une lame
de couteau glissant sur sa langue…Ailleurs, ce sont des objets, comme la boîte
aux baguettes divinatoires du temple Kentun, dont la description impose la présence…Surtout,
il est des tableaux et des paysages dont la réussite est presque bouleversante
: ainsi le port de Maizuru après l'armistice, cette image de la campagne japonaise,
sans couleurs vives, terne plutôt, belle pourtant, où la moisson faite, le riz
pend aux chevalets de séchage : détail simple, qui pourtant touche au meilleur
du secret nippon.
Ségolène, avril 2001
Mishima Yukio Le Pavillon d'Or. Editions Gallimard, 1961 pour la traduction française / Folio n°649.